|
Dans
quelques instants, il sera à coté de nous. Lui, l’héritier
des Nilsson, des Tim Hardin et des plus grands songwriters folk. L’auteur
de trois albums merveilleux qui forment un triptyque magique, à
conseiller aux jeunes gens sentimentaux comme aux nostalgiques du
temps jadis. Une voix d’ange qui fait dire que finalement, on a peut-être
perdu Jeff Buckley, mais on n’a pas tout perdu quand même. Pour
le moment, nous attendons dans ce bar australien près de l’Opéra,
nerveux. Charles Berberian commence à dessiner, et je me demande
si Ron Sexsmith sera bavard, si une discussion va s’instaurer entre
nous ou s’il va se contenter de répondre poliment à
nos questions. Mais la porte vient de s’ouvrir et surgit l’homme,
fort comme dans nos rêves et grand comme il le mérite.
Ron
Sexsmith : J’ai moi aussi fait des bandes dessinées
quand j’étais enfant. Je continue à dessiner, surtout
quand j’ai du temps à perdre, dans les aéroports par
exemple. J’ai toujours un carnet avec moi dans lequel je dessine et
j’écris des textes de chansons. Enfant, j’adorais l’Incroyable
Hulk et la série des Peanuts. Mais ça
fait un moment que je ne me suis pas plongé dans la lecture
d’un comics.
Charles
Berberian : Au Canada, il y a actuellement une série d’excellents
auteurs comme Seth ou Chester Brown et je trouve que, comme eux, tu
arrives à véhiculer dans tes chansons beaucoup de choses
avec simplicité. Alors que la poésie, ce sont toujours
des grandes phrases...
Si Leonard Cohen est surtout connu en tant que poète, je
ne le trouve jamais meilleur que quand il écrit des chansons.
Dans That’s no way to say goodbye, il dit tout ce que tu peux
dire sur la rupture en deux phrases. Son écriture est vraiment
directe et simple. C’est tellement simple que c’est presque du niveau
d’une conversation : I’m not looking for another, as I wander in
my time, walk me to the corner, our steps will always rhyme ("Je n’en
cherche pas une autre / Alors que j’erre comme un apôtre / En
quête d’un coin qui soit nôtre / Où nous vivrons
l’un pour l’autre" dans la traduction de Georges Chelon - Ndlr.).
Je mourrai pour écrire deux lignes pareilles.
|
|
|
Ron
Sexsmith, autoportrait
|
Ch.
B. : Ce que j’aime dans tes textes, c’est la manière dont tu
abordes des sujets universels d’une façon très simple,
comme sur Under every sky...
Il existe une version de cette chanson enregistrée par
des lycéens. Une fille de 14 ans la chante avec une voix d’une
telle pureté que je crois que c’est la plus belle chose que
j’ai entendue de ma vie. Quand tu écris une chanson, c’est
dur de pouvoir t’en détacher. Mais en l’entendant dans la bouche
de cette jeune fille, c’est comme si je l’entendais pour la première
fois. On aurait dit que c’était une chanson pour enfants. Mais
toutes les chansons dont tu me parles sont sur mon deuxième
album. Peut-être que je devrais les jouer plus souvent en concert...
Ch.
B. : C’est le disque par lequel je t’ai connu, et j’ai été
surpris quand j’ai découvert le premier, parce qu’il n’y a
pas de perte de qualité de l’un à l’autre, alors qu’en
général le deuxième album est le plus difficile.
Ça a été un disque difficile. Mais j’ai la
chance d’être assez prolifique. Alors que j’étais en
tournée suite à la sortie du premier album, j’ai commencé
à écrire le second, ce qui fait que nous nous sommes
retrouvés avec plus de 50 chansons entre lesquelles il fallait
choisir. Ça a été difficile. J’avais moins confiance
en moi que pour Whereabouts qui est un peu plus enjoué.
Une de mes chansons préférées sur ce disque est
Seem to recall. Je suis content que nous soyons arrivés
à enregistrer une version suffisamment bonne de ce morceau
pour qu’il figure dessus. Mais je pense déjà à
l’album suivant. J’ai déjà écrit toutes les chansons,
mais rien n’est encore enregistré.
Ch.
B. : Tu joues les chansons jusqu’à ce que tu les juges satisfaisantes
?
Quand j’ai une idée, que ce soit en regardant par la fenêtre
ou en entendant quelqu’un parler, c’est comme si une petite lumière
s’allumait au-dessus de ma tête. Quand je vois que j’ai matière
à en faire une chanson, je me concentre sur l’idée que
je viens d’avoir. Parfois, c’est juste un titre comme c’était
le cas pour Thinking out loud sur Other songs. J’essaie
alors de mettre une mélodie sur ces mots et je les chante de
plein de façons différentes. Jusqu’à ce que je
trouve une mélodie que je n’ai pas l’impression d’avoir volé
à quelqu’un (rires). Ensuite, c’est une question de travail
: trouver quel accord irait bien avec tel autre...
Ch.
B. : Mais ça à l’air si fluide quand on l’écoute...
Pour moi, cette chanson est un véritable standard.
Oh, merci. Pour It never fails par exemple, j’ai trouvé
la mélodie avant le texte. Et j’ai hésité un
bon moment avant de savoir de quoi j’allais parler. J’avais au moins
sept couplets différents à l’arrivée. J’écris
beaucoup et je ne jette rien. Le pont, dans cette chanson, est extrait
d’un autre titre que je ne suis jamais arrivé à finir.
J’ai une approche de l’écriture qui est assez classique. Je
crois beaucoup au mariage parfait entre le texte et la mélodie.
Les paroles, c’est ce sur quoi je passe le plus de temps. Je peux
rester cinq mois sur un texte si je bloque dessus.
Ch.
B. : Quand j’achète un de tes disques, je lis d’abord les paroles
dans le livret et je me demande ensuite comment tu vas chanter ça,
parce que tes textes sont plus écrits comme des nouvelles que
comme des paroles de chansons, je pensais par exemple à Pretty
little cemetery...
Nous habitions de l’autre coté du cimetière, et
un dimanche que mon jeune fils et moi nous nous promenions, il m’a
posé des questions au sujet des corps qui sont sous la terre.
C’est de là qu’est parti Pretty little cemetery. Je
me souviens d’avoir eu peur que le titre de la chanson paraisse un
peu idiot au début. Mais finalement, je ne suis pas loin de
penser que c’est un de mes meilleurs textes. Et je ne crois pas que
tu puisses lire mes textes comme si c’était de la poésie
parce qu’ils sont faits pour être chantés.
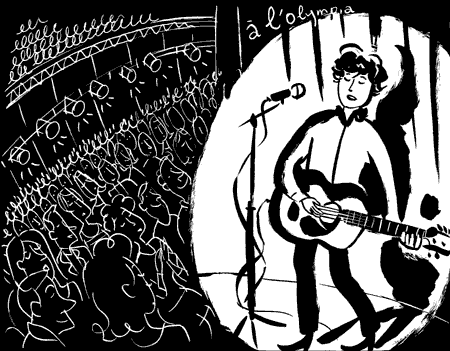 Ch.
B. : Je suis aussi fasciné par la finesse de tes arrangements.
Avec des chansons comme les tiennes, tu pourrais être tenté
de les arranger de façon beaucoup plus commerciale et vendre
beaucoup plus de disques. Comment bosses-tu avec ton producteur Mitchell
Froom (1) ? Ch.
B. : Je suis aussi fasciné par la finesse de tes arrangements.
Avec des chansons comme les tiennes, tu pourrais être tenté
de les arranger de façon beaucoup plus commerciale et vendre
beaucoup plus de disques. Comment bosses-tu avec ton producteur Mitchell
Froom (1) ?
Avant d’aller en studio, Mitchell et moi on s’enferme pendant
une semaine ou deux, moi avec ma guitare et lui avec son clavier,
et nous passons en revue toutes les chansons que j’ai écrites.
Pour Whereabouts, nous n’avons conservé que 12 titres
parmi les 17 qui avaient été enregistrés. Mitchell
fait beaucoup de suggestions quant au tempo et aux arrangements. Pour
Beautiful view, c’est moi par contre qui ai insisté
pour qu’on écrive une intro -parce qu’aujourd’hui, plus personne
n’écrit d’intros. Je pensais aux disques de Dusty Springfield
qui en comportent de si merveilleuses. La première fois que
nous avons travaillé ensemble, Mitchell ne savait pas quel
parti pris adopter. Il a finalement préféré mettre
au premier plan ma guitare et ma voix, et j’étais très
content de ce choix car je ne voulais pas que mon premier disque soit
surproduit. J’aime beaucoup les chanteurs. Je suis très observateur
du travail de Sinatra par exemple, de la façon dont il va traîner
sur une note, comme sur The wee small hours par exemple. Dusty
Springfield, Leonard Cohen, Chet Baker... Il y a un bar dans lequel
je vais chanter chaque fois que je suis à San Francisco, accompagné
par une femme au piano. Je chante Time after time, But not me,
Everytime we say goodbye... C’est mon style de chansons, là
d’où je viens. Même si c’est moi qui écrit mes
morceaux, j’essaie à chaque fois de les aborder comme si j’étais
juste leur interprète. Avec beaucoup de respect pour la chanson,
en s’effaçant presque derrière elle comme le faisait
Chet Baker. Je crois que beaucoup de chanteurs ont beaucoup à
apprendre de lui.
Ph.
D. : Et toi, grâce à qui as-tu appris ?
Quand j’étais enfant, il y avait toujours de la musique
à la maison, que ce soit des disques ou la radio. Ma mère
avait une bonne collection de 45 tours, et je crois que le premier
plaisir que j’ai pris, c’est de pouvoir les jouer moi-même.
Je devais avoir 5 ans et ma grande satisfaction était de les
écouter sans l’aide d’un adulte. C’était essentiellement
des 45 tours du début des années 60, comme ceux de Buddy
Holly ou Johnny Cash. Je jouais la face A et la face B. Puis j’ai
commencé à m’intéresser aux grands disques :
les 33 tours. Tammy Wynette, Charlie Rich... Mon frère était
passionné de hockey, mais moi je préférais rester
à la maison écouter de la musique. Même quand
j’étais dehors, je m’arrangeais pour qu’il y ait un transistor
à coté de moi pour rester dans ce confort musical.
Ph.
D. : Quel âge avais-tu quand tu as acheté ton premier
disque ?
Je devais avoir 10 ans. On m’avait déjà offert des
45 tours à Noël, mais le premier disque que je me suis
offert, c’était Captain Fantastic d’Elton John. Je me
souviens très bien qu’il coûtait 3.99$ et que j’avais
dû tondre la pelouse pour me le payer. Il y avait un poster
à l’intérieur, et j’aimais beaucoup la pochette. Je
crois que c’est un excellent premier disque. Elton John était
mon héros quand j’avais 10 ans. J’ai acheté tous ses
disques, et c’est le premier concert que j’aie jamais vu. C’est grâce
à Elton John que j’ai découvert les Who, c’est grâce
aux Who que j’ai découvert les Kinks... Tout est parti de là.
Ph.
D. : C’est Elton John qui t’a donné envie d’être musicien
?
J’ai toujours rêvé d’être chanteur. Quand j’étais
plus jeune, je chantais pour les membres de ma famille. J’ai toujours
voulu être celui qui se tient face au micro. À 14 ans,
quand j’ai formé mon premier groupe, je voulais déjà
être chanteur. Et comme il y avait déjà un batteur
et un clavier, j’ai dû me mettre à la guitare, presque
par obligation. Mais une fois que je m’y suis mis, j’ai trouvé
ça plutôt facile. Par contre, je n’avais jamais eu l’occasion
d’approcher un piano. Ce n’est que très récemment que
je m’y suis mis. La guitare, c’est un second choix : le premier, c’était
le chant. J’adorais Harry Nilsson et Charlie Rich. J’ai dédié
mon premier album à Harry Nilsson.
Ch.
B. : Je vois beaucoup de ressemblance dans ta façon d’écrire
des chansons et de faire en sorte, même quand elles sont très
élaborées, qu’elles aient l’air très simples.
Merci. Écrire des chansons, c’est à peu près
la seule chose que je sache faire. Je suis incapable de conduire une
voiture, je ne sais pas faire la cuisine... Alors quand j’écris
des chansons, je veux que ce soit bien fait. Avant que j’aille en
studio les enregistrer, je veux être sûr que le texte
aille bien avec la mélodie, qu’il ait un sens, qu’il s’adresse
à l’auditeur d’une façon assez directe comme je veux
que la mélodie soit facilement reconnaissable. Tous mes héros
étaient d’excellents mélodistes.
Ch.
B. : Rod Stewart a repris un de tes morceaux. T’imagines-tu un jour
écrire pour les autres comme le faisait Burt Bacharach ?
J’ai du respect pour les gens qui écrivent à la
chaîne au fond d’un bureau car je sais que ce n’est pas de là
que viennent leurs idées : ils les ont plutôt dehors,
quand ils sont sur le chemin de chez eux. Je sais que Bacharach écrivait
beaucoup lors de ses promenades. Un réel talent d’écriture,
c’est quelque chose qui manque aujourd’hui, parce que les chansons
me semblent plus reposer sur le rythme ou le climat. Moi, j’aime pouvoir
ramener les chansons à juste la formule guitare-voix. Et, s’il
s’agit d’un morceau instrumental, être capable de le fredonner.
Ch.
B. : Tu connais l’album de standards de Nilsson ?
Oui. La vidéo qui retrace l’enregistrement de ce disque
est étonnante. Tu le vois fumer et enchaîner les morceaux
face à l’orchestre, en disant " suivant " à la fin de
chaque morceau, très hautain.
Ch.
B. : Et toi, tu fumes ?
De temps à autre. C’est à cause de la cigarette
qu’il a perdu sa voix, alors je fais attention. C’était un
gros fumeur.
Discographie
Ron
Sexsmith (Interscope/Universal) 1995
Other
Songs (Interscope / Universal) 1997
Whereabouts (Interscope / Universal) 1999
Blue Boy (Cooking Vinyl/Naïve) 2001
(1)
Mitchell Froom a travaillé aussi bien avec Crowded House, Elvis
Costello, Richard Thompson, Los Lobos, Cibbo Matto ou Paul Mc Cartney.
Il fut un temps le mari de Suzanne Vega.
|


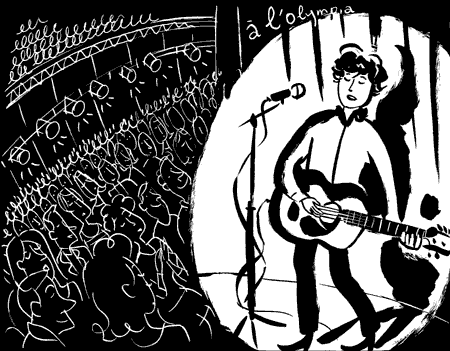 Ch.
B. : Je suis aussi fasciné par la finesse de tes arrangements.
Avec des chansons comme les tiennes, tu pourrais être tenté
de les arranger de façon beaucoup plus commerciale et vendre
beaucoup plus de disques. Comment bosses-tu avec ton producteur Mitchell
Froom
Ch.
B. : Je suis aussi fasciné par la finesse de tes arrangements.
Avec des chansons comme les tiennes, tu pourrais être tenté
de les arranger de façon beaucoup plus commerciale et vendre
beaucoup plus de disques. Comment bosses-tu avec ton producteur Mitchell
Froom