|
Jade :
Peux-tu nous parler de ce qui t’a amené à la bande dessinée ?
Martin Tom Dieck :
Nous étions quatre amis, on se voyait le soir, on discutait,
on dessinait, il y avait de la compétition entre nous, ça
a été un catalyseur. À l’adolescence j’ai découvert
une bande dessinée qui n’était pas pour enfant, avec
À suivre... ou Métal Hurlant, où il y avait une
certaine qualité. Au début de mes études aux
Arts appliqués je me suis intéressé à
la peinture, c’est un monde qui m’attirait, mais j’ai hésité
à y entrer, c’était sans frontière. Plusieurs
de mes amis sont peintres, je sais les questions qu’ils se posent,
c’est un terrain qui possède une tradition plus longue, plus
forte, développer un style là-dedans est particulièrement
difficile. Sans parler des difficultés pour en vivre. J’avais
l’idée que -même si ça n’était pas très
bien accepté- il pouvait y avoir un tout autre rapport à
la bande dessinée. Alors j’ai décidé d’essayer
d’explorer un peu plus ce médium.
 Comment
a été perçu ton travail sur la bande dessinée
aux arts appliqués ? Comment
a été perçu ton travail sur la bande dessinée
aux arts appliqués ?
Ce médium était très peu utilisé,
il n’y avait pas de professeur dans ce domaine. Depuis quelques années
Anke Feuchtenberger donne des cours là-bas, elle s’occupe des
gens qui veulent faire de la bande dessinée. À l’époque
ce n’était pas très bien accepté, mais ça
ne me dérangeait pas. Je ne cherchais pas l’inspiration dans
ce qui existait déjà, je considérais la bande
dessinée comme une sorte de terrain vague sur lequel je pouvais
faire des expériences. Je cherchais une porte d’entrée
qui me soit personnelle dans ce médium. À la fin de
mes études j’ai fait un travail théorique, sur l’architecture
déconstructive, et j’ai obtenu une bourse qui m’a donné
deux ans pour travailler sur mon premier livre, L’innocent passager.
À l’issue de cette bourse ils organisaient une exposition et
ils éditaient un petit catalogue, mais comme j’avais un projet
de livre ils ont cherché des fonds afin de le sortir. J’ai
eu la chance de suivre ce premier livre de l’idée initiale
jusqu’à la réalisation finale. Je suis allé récupérer
mes livres à l’imprimerie, j’en avais un stock dans mon appartement,
je les amenais dans les librairies, je les vendais dans mon sac à
dos, c’était ma première publication et ça me
plaisait beaucoup d’avoir tout en main. Après, j’ai commencé
à travailler avec les gens de la revue Strapazin de
Zürich.
Qu’as
tu rejeté dans la narration traditionnelle et qu’as tu remplacé ?
Il y a très peu de texte, par exemple dans tes récits…
Je ne suis pas écrivain. Écrire des textes, inventer
des histoires qui littérairement marchent bien m’est difficile.
En plus si on veut utiliser le texte graphiquement, c’est mieux qu’il
y en ait peu. J’ai du mal à lire les bandes dessinées
qui ont trop de texte. Le rapport entre une histoire graphique et
la musique m’intéresse et je trouve que le rapport est plus
proche s’il n’y a pas de texte. Une histoire muette fonctionne sur
un autre rythme.
"Une bande dessinée est plus proche de la musique
s’il n’y a pas de texte."
La
structure de tes récits est très circulaire.
Le type de récit circulaire que j’utilise est un peu à
mon image, je me dévoile beaucoup dans mon travail, mais de
manière dissimulée. Certains dessinateurs attaquent
le public avec leur propre vie, je me sens plus discret. Par exemple
je donnerais un sentiment que je connais à un personnage, tout
en coupant les liens trop forts avec moi, afin qu’il puisse exister
sans moi, sans que j’ai à l’expliquer. C’est vrai que souvent
chez moi la fin est similaire au début -(soupirs). J’aimerais
faire d’autres choses mais ça a tendance à revenir naturellement
dès que j’essaie de développer une histoire. Je ne comprends
pas exactement ce que je fais, mais je sais que j’aime utiliser ces
structures circulaires. J’utilise par exemple des jeux très
simples avec le texte, comme ne pas mettre de point à la fin
d’une phrase. Une phrase sans signe qui la clôt peut être
lue de plusieurs manières.
Dans
tes récits, il y a très peu d’éléments.
Comment es-tu arrivé à cette épure ?
Si on la prend au sérieux, la réalisation d’une
bande dessinée est très complexe. Il y a tellement de
décisions à prendre qu’il faut en restreindre la quantité.
Je travaille en noir et blanc, parce que mettre de la couleur serait
trop pour moi. De même, j’utilise une mise en page très
simple, des cases de même format, une image ou deux par page...
J’ai essayé d’organiser une double page classique, avec une
grille de cases, mais c’est tellement difficile. Avec les personnages
il y a une difficulté d’ordre littéraire -(soupir)-.
Je ne sais pas si je parviendrai un jour à faire quelque chose
de littérairement plus élaboré, avec des personnages
qui aient une réelle profondeur psychologique.
La
notion d’espace semble essentielle chez toi, de quelle manière
la travailles-tu ?
L’espace qu’il y a entre deux cases est tellement particulier
à la bande dessinée, c’est quelque chose de très
simple, mais c’est ce qui est la cause de son aspect vivant. Les images
sont fixes, l’énergie passe entre elles, entre les cases, mais
aussi entre le texte et l’image. Quand j’ai commencé je m’intéressais
à l’expérimentation. Le contenu me paraissait moins
important que le médium même. Je travaillais de manière
associative en utilisant des images qui me plaisaient, comme celles
de l’architecture déconstructive par exemple, que je reliais
entre elles avec un certain sentiment d’intensité, plus qu’à
travers une logique narrative. C’est assez subjectif, je ne sais pas
vraiment si je pourrais l’expliquer. Disons que je pense qu’une bande
dessinée ou un morceau de musique est quelque chose d’organique,
un récit n’est pas composé que de signes lisibles, il
recèle un monde derrière les traits. C’est assez immatériel,
et pour moi ça a à faire avec l’architecture. Il y a
une suite de pièces avec des portes qui conduisent vers d’autres
pièces ou qui mènent dehors. C’est quelque chose qu’il
est possible d’organiser. Dans la Grèce Antique ceux qui faisaient
de la rhétorique utilisaient des images architecturales pour
pouvoir mémoriser les structures de conversation. Ils organisaient
leur pensée à la manière d’une maison avec des
pièces, des portes, dont ils étaient capable de faire
le tour. L’organisme est également une bonne analogie pour
décrire un récit, je pense en particulier aux organismes
naturels, comme des plantes, des fleurs ou même une infection
qui te donnerait de fortes poussées de fièvre. Le récit
aura alors la structure d’un corps transpirant après les assauts
de la maladie. J’essaye de transmettre ce genre de choses dans la
bande dessinée.
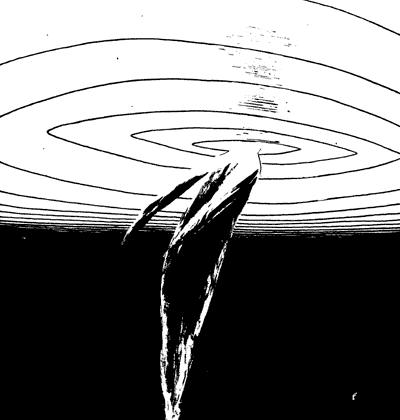
Le petit livre carré paru aux éditions
Arrache Cœur se parcourt comme un espace en trois dimensions. Comment
s’est-il construit ?
Hundert Ansichten der Speicherstadt -je sais que ce titre
est imprononçable en Français (rire)- a été
très libre, je n’avais pas de responsabilité envers
le monde réaliste. Quand j’aborde un sujet je commence par
le complexifier, c’est à dire que je lis énormément,
je note beaucoup d’idées, j’essaye d’établir des relations
entre une idée et une autre, je regarde si ça fonctionne,
et si ça ne marche pas j’essaye avec d’autres, jusqu’à
obtenir quelque chose de suffisamment dense pour que je puisse m’y
immerger et le lire avant de choisir une direction dans laquelle m’orienter.
Quand je travaille sur un récit, je fais attention à
rester constamment lecteur de mon propre travail, à ne pas
le faire uniquement pour les autres, afin de conserver un recul qui
me permet de choisir les éléments qui me donneront une
certaine impression. Il y a une théorie de la psychologie,
la Gestalt, qui considère que l’on perçoit le
monde par images, jamais dans son ensemble. Nous en retenons certaines
images qui nous servent à nous raconter une histoire à
nous même, que nous pouvons ensuite raconter aux autres et c’est
ainsi que l’on donne sens au monde. C’est l’idée que l’on peut
lire le monde qui nous entoure ; pas seulement lorsqu’on fait
une bande dessinée, mais tout le temps.
Comment
est venue l’idée de Salut Deleuze ?
Souvent les artistes ou les philosophes ont des morts stupides,
je crois que Roland Barthes s’est fait écraser par une voiture,
Antonio Gaudi a été écrasé par un tramway
-ce qui est dommage (rire). Lorsque j’ai appris la mort de Gilles
Deleuze je me suis tout de suite demandé s’il était
passé par la fenêtre par accident -je ne savais pas encore
ce qui s’était passé. Je n’avais lu qu’un seul petit
livre de lui, et ma réaction immédiate a été
« hep, un moment, je ne les ai pas encore tous lus,
j’aimerais vous poser une question », mais c’était
raté, trop tard. Au même moment la revue Allemande Boxer
m’a proposé de faire un récit -qui n’est en fait jamais
paru- et je me suis dit pourquoi ne pas faire un hommage à
Deleuze. J’ai commencé à suivre ce fil afin de mettre
sur papier quelque chose en rapport avec son œuvre, mais je me suis
vite rendu-compte que je n’avais pas assez de notions philosophiques,
en tout cas pas assez pour retranscrire sa pensée, alors j’ai
demandé à Jens Balzer de m’aider à faire quelque
chose d’un peu plus long. C’est lui qui a eu l’idée de la répétition,
qui est un sujet central chez Deleuze. L’idée était
que ce soit accessible à un lecteur de bande dessinée,
pas nécessairement à un lecteur de Deleuze. Jens a rédigé
les dialogues, il a construit le structure de ce récit où
la traversée se répète plusieurs fois afin de
laisser le temps aux deux personnages de continuer à débattre,
de manière un peu étrange. Ça leur prend quand
même quelque temps pour réaliser qu’ils se retrouvent
dans une répétition . Du fait qu’il y avait peu d’images,
qui se répétaient, j’ai dessiné l’album très
vite (rire). Ensuite j’ai dû faire le montage, qui était
assez difficile, j’avais du mal à avoir du recul. Quand j’ai
reçu le livre j’ai découvert qu’il y a un certain humour
qui n’avait pas été prévu par nous, ça
a été une bonne surprise. Le fait que ce travail se
fasse vite a été une évasion par rapport à
L’innocent passager, qui était beaucoup plus compliqué
à réaliser. Je l’avais dessiné case par case
sans savoir comment cela continuait, en me demandant tout le temps
si ça marchait. Parfois ça devenait un peu fou, à
force de me demander si ça avait un sens, je manquais de me
perdre dans toutes les associations d’idées. Et puis un jour
j’ai réalisé que je me retrouvais dans la même
situation que le personnage, j’étais sur un bateau que je ne
connaissais pas, je cherchais le capitaine, en attendant que quelqu’un
vienne me prenne par la main pour m’entraîner dans la soute…
Ce travail a été un voyage intense.
Sur
quel projet travailles-tu en ce moment ?
Actuellement je travaille sur l’histoire d’un écrivain
qui a vécu dans l’entre-deux-guerres, il s’agit d’un projet
tout à fait différent où je me pose des questions
complètement nouvelles. J’aimerais éviter cette fois
une certaine mélancolie, je suis en train d’établir
le plan d’un scénario qu’il ne me restera plus qu’à
illustrer, c’est très nouveau pour moi. Il s’agit de quelque
chose que j’ai toujours voulu éviter jusque là, mais
je sens qu’il faut travailler différemment sur ce sujet, même
si je ne sais pas encore exactement comment. J’ai beaucoup de textes
sur l’époque. Cet écrivain s’appelle Walter Mehring.
Il est connu en Allemagne parce qu’il a écrit beaucoup de chansons
de cabaret, des poèmes et des choses satiriques. Par contre
il s’agit d’un écrivain dont les textes autobiographiques sont
très peu nombreux, et qui en plus a fait relativement peu de
fiction. Il s’agit en général de petites histoires passionnantes,
je pense les mêler à des choses qui se sont réellement
passées dans le contexte de l’époque. Il a notamment
écrit un livre que j’aime beaucoup, La bibliothèque
perdue, où il parle de la bibliothèque de son père
dont il a hérité et qu’il a perdue après sa fuite
pendant la guerre. J’essaie d’utiliser uniquement ses textes, de le
laisser s’exprimer comme un scénariste, je ne crois pas que
je vais faire des dessins documentaires. J’aimerais qu’il y ait une
certaine atmosphère Berlinoise des années 20, où
le Paris des années 40, mais j’aborderai plus librement cet
aspect-là, pour garder des sensations personnelles. Je préfère
ne pas trop y réfléchir avant. Je crois qu’il faut aborder
ça comme une peinture. Tu fais le premier trait et l’image
commence à vivre, tu sens apparaître un grain qu’il faut
nourrir, conserver. Il faut se laisser dicter la suite par le premier
trait. Si on a une idée trop précise d’une image, il
est improbable que cela devienne une bonne image, une bonne peinture.
Il peut aussi arriver que tu restes trop près de cette idée
initiale, sans explorer ce qui l’entoure, cela risque alors de devenir
trop sec, tu auras des os mais pas de chair. Un peintre Allemand dont
j’ai oublié le nom a dit "j’aimerais que mes peintures
soient plus sages que moi". C’est à dire qu’il ne
faut pas savoir tout ce qui se passe dedans. Dans les images des rêves,
il y a une certaine logique, mais on ne sait pas laquelle. J’aime
bien que ce genre de sentiment passe dans les récits, qu’on
se demande de quel monde parle l’auteur, que l’on puisse chuter à
l’intérieur, comme c’est le cas avec le Alice d’Atak,
où rien n’est jamais vraiment clair, à commencer par
le titre Embrasse la lune avant qu’elle ne s’endorme. Je pense
souvent à ce livre, que je viens de relire. Il s’agit d’une
autre voie, où je me sens un peu dérangé, comme
un délire, c’est une voie qui m’intéresse plus que le
travail réaliste, ou littéraire. Ce que nous faisons
tous les deux est peut être plus poétique.
"Un
récit peut avoir la structure d’une infection qui te donnerait
de fortes poussées de fièvre."
Est-ce
possible de se faire éditer en Allemagne lorsqu’on fait une
bande dessinée plus expérimentale ?
Ça dépend du degré d’expérimentation.
Il n’y a pas la même tradition éditoriale qu’en France
ou en Belgique, même si ça a beaucoup changé ces
dernières années. À Hambourg il y a beaucoup
de dessinateurs amateurs, certains comme Hubert Markus sont publiés,
il y a un milieu de dessinateurs à Berlin, à Munich,
Stuttgart. Je connais les gens de Munich un peu et les gens
de Berlin. De plus en plus de dessinateurs publient des choses eux-mêmes,
il y a plusieurs petites maisons qui se défendent. Depuis la
chute du mur, des dessinateurs de l’Allemagne de l’Est qui venaient
d’une autre tradition graphique ont vraiment enrichi le genre. Mais
mon éditeur est Suisse (rire). En Suisse je crois que ça
marche mieux.
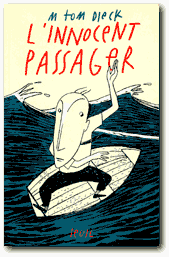  Tes
livres sont diffusés en Allemagne ? Tes
livres sont diffusés en Allemagne ?
En Allemagne c’est difficile, je crois qu’il y a seulement deux
librairies où on peut trouver les livres de l’Association.
Salut Deleuze, est plus connu en France qu’en Allemagne. J’ai
l’impression que mes idées sont plus appréciées
ici. En plus en France il y a plus de petites maisons qui font des
livres et des revues, en Allemagne il n’y pas beaucoup d’expériences
de ce type.
Comment
as-tu rencontré les petits éditeurs de bande dessinée
de langue française ?
En 1994, Fréon a organisé à Bruxelles une
rencontre des revues indépendantes comme Lapin, Cheval
sans tête, des Espagnols et des Allemands, des Suisses,
Boxer. C’était une grande rencontre où j’ai vu
beaucoup de choses pour la première fois, ensuite on a commencé
à se publier mutuellement. Et depuis je suis en contact avec
Fréon et Amok. Strapazin a une grande rédaction
et pour chaque numéro ils sont deux ou trois à s’occuper
d’un numéro, ils choisissent par exemple de présenter
le travail d’Amok, ou de Fréon, ou certains dessinateurs Américains,
ou Finlandais.
Comment
vois-tu la démarche de ces éditeurs ?
En comparaison avec ce que je connais de l’Allemagne, il y a une
certaine richesse. Je pense que vous avez ici une certaine tradition
et une certaine attitude éditoriale. Les petites maisons d’édition
françaises existent vraiment beaucoup, par exemple une revue
comme Lapin a une préface, ce qui témoigne d’un
certain sérieux, derrière lequel on sent une ambition.
Au festival de Fillols j’ai croisé un jeune type qui voulait
fonder une revue, il avait une démarche, son ambition était
visible, il cherchait à rencontrer des dessinateurs, ça
c’est très fort ici. Moi qui suis étranger à
cette culture, je regarde ce qui se passe de l’extérieur et
ça me laisse songeur. Je me dis : "quelqu’un d’aussi
jeune qui veut monter une maison d’éditions, hum, hum"
(rire). Du côté économique, je ne sais pas
très bien comment ça marche, j’en ai parlé avec
Thierry Van Hasselt de Fréon, par exemple, je ne sais pas comment
ils font, je pense qu’ils travaillent à côté -je
ne sais pas si quelqu’un peut gagner sa vie avec ça.
Et
toi, tu gagnes ta vie avec ton travail en bandes dessinées ?
Non, pas du tout, je gagne ma vie en étant illustrateur,
je donne des cours de temps en temps, pour la bande dessinée
je reçois parfois des droits d’auteur symboliques. Mais ça
me plaît que ça reste quelque chose à côté,
qui n’a pas beaucoup à faire avec l’argent. Si je voulais gagner
plus d’argent avec ça ou être plus connu, ce serait mieux
de produire un album chaque année mais je n’y arriverai pas,
parce que je travaille très lentement, pour moi c’est important
de laisser mûrir les choses longtemps, c’est quelque chose que
je ne veux pas perdre. C’est une décision que j’ai pris dès
le début : faire ce que je veux, même arrêter,
ou ne rien produire pendant des années, même si, c’est
évident, je préférerais avoir plus de temps à
consacrer à mes projets, avec une plus grande disponibilité
d’esprit.
|

 Comment
a été perçu ton travail sur la bande dessinée
aux arts appliqués ?
Comment
a été perçu ton travail sur la bande dessinée
aux arts appliqués ? 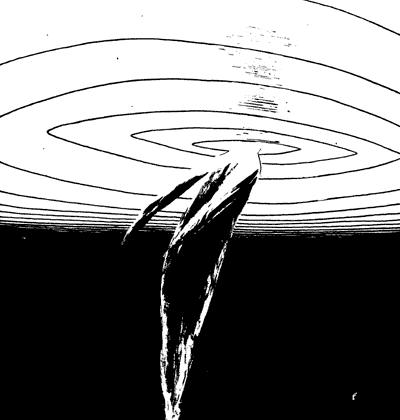
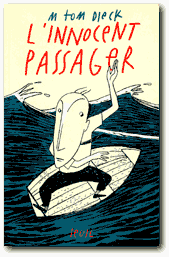
 Tes
livres sont diffusés en Allemagne ?
Tes
livres sont diffusés en Allemagne ?