|
Jadeweb
: Tu dessinais étant enfant ?
Stephane
Barry : Oui, je dessinais. J’utilisais tout ce qui pouvait me
permettre de construire un univers personnel, cela pouvait être
des dessins, des constructions, tout ce qui était susceptible
de se mettre au service des univers que je m’inventais. L’important
était de donner corps à ces rêveries, d’en laisser
une trace. J’étais déjà très minutieux,
la construction avait beaucoup d’importance, c’était une forme
de refuge, une catharsis, ainsi qu’une manière de jouer et
d’employer mes journées.
Tu
es passé par une école graphique ?
Oui.
C’est bien tombé, car je n’avais pas fait ce choix, au départ :
échec scolaire, refus d’autorité, enfin le cursus normal.
Tu te sens en marge, et puis, à un moment, quelque chose t’aide
à croire à ce que tu as entre les mains. Ensuite, cela
se fait progressivement. Te sachant assuré de certaines bases,
de certaines connaissances, tu doutes un peu moins, même si
tu es timoré…
Il
y a encore du travail à faire quand tu sors de ces établissements,
des automatismes à perdre. C’est comme un geste qui t’a été
inculqué ; tu travailles en fonctionnaire du dessin et
tu n’apportes rien de nouveau. Je n’avais pas le sentiment d’avoir
acquis suffisamment de maturité dans ce que je voulais faire
pour me permettre de m’installer comme artisan du dessin. Ce n’est
qu’après que des gens sont venus me chercher, parce que mon
travail était suffisamment prégnant pour que d’autres
puissent s’y intéresser.
Cette
école n’était pas le lieu pour une recherche. Ils t’apprenaient
simplement à pouvoir répondre à une demande,
mais n’encourageaient pas une étude en profondeur. Après,
c’est un travail de recherche personnel que j’ai dû fournir
en dehors. Si je n’avais pas eu ce besoin de traduire quelque chose
qui me soit propre à travers mes dessins, et non pas une surface
creuse qui puisse englober les demandes extérieures, cela ne
se serait pas fait.
 Comment
es-tu passé du dessin à la peinture à l’huile ? Comment
es-tu passé du dessin à la peinture à l’huile ?
La
peinture est venue justement quand il a fallu envisager autre chose
que les automatismes acquis par l’exercice intensif du dessin. En
fait mon choix de la peinture découle de la B.D. : la
narration se réduit à la case, et la case s’agrandit,
donne une ouverture sur le monde. La peinture est un média
séculaire, qui a une vie tellement longue qu’il ne semble pas
pouvoir mourir… Il ne peut que continuer, suivre des voies aussi différentes
que le nombre de personnes qui les emprunteront. C’est un accès
direct à une émotion, c’est visuel, narratif… ça
peut se relire plusieurs fois, tout en restant un objet direct :
tu as ta toile, le rapport à la chose finie sur le moment.
Tu as aussi le côté voluptueux du matériau… Donc
même si c’est considéré comme rétrograde,
ce n’est pas mort pour autant. Dès que l’on aborde un média,
on ne peut pas en éclipser le côté contemporain
- même si l’on se sert de valeurs anciennes, comme la peinture
à l’huile.
Es-tu
attiré par la succession qu’il y a dans la bande dessinée ?
Non,
je suis adapté à l’image fixe, même si cela peut
s’articuler pour former une narration. Mes images restent très
figées, elles sont suspendues dans le temps. La narration m’intéresse
mais perd les détails, empêche de voir dans chaque chose.
Et puis ce serait trop laborieux pour moi de faire des images aussi
minutieuses que je les conçois sur une longue série.
Je préfère animer une seule page, lui donner son caractère
subjectif au travers des divers éléments qui la composent.
|
cliquez
sur l'image pour aggrandir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
thèmes que tu traites ont quelque chose d’hermétique ?
Oui,
je crois que c’est même un des fondements de mon travail. Le
figuratif prend pour moi son sens là-dedans, comme un agencement
de symboles qui sont signifiants pour tout le monde et qui peuvent
avoir une configuration particulière quand ils sont employés
par toi. Tu détournes le symbole, ce qui fait que tu peux être
compris de diverses manières. C’est de là aussi que
vient mon intérêt pour les mythes, comme Icare, qui est
souvent présent dans mes sujets. Sisyphe aussi, qui est son
opposé - cyclique, alors qu’Icare est plutôt linéaire
et ascendant. Je me sens proche de Dédale également
- les jeux de construction me touchent - mais je ne l’ai pas encore
illustré.
Est-ce
que le fait que tu te consacres la peinture provoque des réactions
d’étonnement ?
Oui.
Mais c’est difficile de parler de cela, parce que je m’en rends compte
uniquement lorsqu’il y a des discussions, pendant les expositions.
Je pense que c’est accepté parce qu’il y a un côté
fortement visuel, qui en même temps en gêne certains.
J’ai eu plusieurs avis, comme ceux de personnes qui penchent plutôt
vers l’art contemporain et qui attendent autre chose de l’art, quelque
chose de plus évolutif -une recherche de nouveauté qui
ne passe que par la technique- et ils se désintéressent
totalement d’un pan du message, d’un sens relatif à autre chose
que notre époque, un sens plus global. Tu n’es pas obligé
d’être dans ton époque, d’avoir fait quelque chose découlant
de Picasso ou Duchamps pour faire partie de l’avant-garde… Je ne crois
pas à cette espèce de fuite en avant qui considère
que tout a été fait et où, si tu n’es pas à
la pointe de la nouveauté, tu n’aurais pas accès à
un sentiment fort. Je pense que cela peut passer par d’autres biais.
As-tu
l’impression que ton travail appartienne à un underground graphique
?
C’est
underground parce que ça n’emprunte pas les voies courantes.
Mais ce n’est pas non plus subversif et provocateur comme on pourrait
l’attendre de ce milieu. Il y a souvent un côté provoc
ou politique, où des gens se mettent en marge par opposition,
ce qui n’est pas forcément mon cas. Je n’ai pas le sentiment
de m’opposer à quelque chose… Je ne nourris pas une animosité
vis-à-vis des institutions : j’ai évolué
dans quelque chose de marginal parce que je n’étais pas forcément
adapté. Dans mon rapport au monde, je ne me sers pas de ma
personne pour évoluer dans la sphère " artistique ",
je me sers plutôt de ce que j’investis dans mon travail pour
cela…
Comment
ton entourage a pris ton orientation ?
Ça
a été perçu bizarrement, mais avec le recul assez
bien finalement. Il n’y a pas eu de refus catégorique, je n’ai
pas eu des contraintes de ce côté là. Le problème
s’est posé quand la réalité m’a rattrapé,
quand j’ai été obligé de me dire qu’il fallait
manger de ce que j’avais entre les mains. Tu fais des compromissions,
et c’est toi-même qui te poses le plus de problèmes.
Les gens qui sont autour de toi te suivent, s’ils te font confiance.
Tu
arrives à en vivre ?
C’est
un bien grand mot, mais je réussis à ne faire que ça.
Même si mon boulot a un faible impact géographique, et
passe par le bouche à oreille.
Quelle
peut être la place d’un peintre aujourd’hui ?
Il
n’y en a pas, je pense. C’est à toi de t’adapter… J’ai fait
un choix qui n’est pas forcément aisé ; j’aurais
pu mieux cibler mon travail... C’est pour cette raison que j’apprécie
le côté artisanal, qui te permet d’éviter certaines
prétentions. Si par exemple les musées d’art contemporain
désapprouvent ton orientation, et bien tu fais une croix dessus,
et puis voilà. Tu acceptes la critique, et tu te dis on verra
après, il y a sûrement d’autres voies, d’autres gens
- qui ont une autre expérience, une autre vie, quelque chose
de fort, et pas seulement une culture pour comprendre des références.
Ce n’est pas une situation très facile, mais bon, c’est un
choix.
|
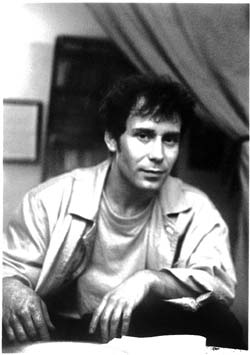
 Comment
es-tu passé du dessin à la peinture à l’huile ?
Comment
es-tu passé du dessin à la peinture à l’huile ?


