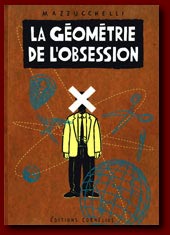|
 Il
nous semble que vous êtes plus connu en France comme auteur
dans la production indépendante que comme illustrateur de séries
telles que Daredevil ou Batman. Est-ce la même
chose aux Etats Unis ? Il
nous semble que vous êtes plus connu en France comme auteur
dans la production indépendante que comme illustrateur de séries
telles que Daredevil ou Batman. Est-ce la même
chose aux Etats Unis ?
Il
y a beaucoup de fanas de super-héros en Amérique -et
partout ailleurs- qui ne savent pas que j’ai fait d’autres comics
depuis Batman (la série Batman : Year one
sur un scénario de Frank Miller parue en France dans la collection
"Super héros" de Comics USA). Ces gens pensent que je
ne suis qu’un illustrateur de Daredevil ou Batman, que,
pour certaines raisons, j’ai arrêté de dessiner. Puis
il y a des gens, dont la connaissance des comics est plus approfondie,
qui s’intéressent essentiellement à des choses plus
alternatives. Ceux-ci pensent à moi comme quelqu’un qui a commencé
par des travaux grand public pour ensuite s’orienter vers une vision
plus personnelle du comics. Mais, dans la plupart des pays, ils ne
représentent qu’un petit groupe de personnes. D’autres gens
encore ne me connaissent que pour mes travaux d’illustration dans
The New Yorker, et peut-être aussi pour l’adaptation
du livre de Paul Auster, Cité de verre. En fait,
cela dépend à qui vous posez la question.
Au
cours des années 80, Frank Miller a été la figure
emblématique du renouveau du comics. Vous avez eu plusieurs
collaborations avec lui, son travail vous a-t-il beaucoup influencé ?
J’ai collaboré deux fois avec Frank Miller. D’abord sur
quelques épisodes de Daredevil, puis sur Batman.
Les premiers travaux de Frank sur Daredevil font partie de
ce qui m’a donné envie de faire des comics de super-héros.
Notre collaboration a été excellente et m’a énormément
appris. Comme dans toutes les bonnes collaborations, chacun doit apprendre
quelque chose de l’autre. Mais dire que ce travail a directement influencé
ce que je fais aujourd’hui, c’est comme dire que le mauvais temps
vous pousse à ne pas sortir. J’ai appris beaucoup de choses
en travaillant dans l’industrie du comics dont je peux me servir d’une
manière ou d’une autre aujourd’hui, bien que mon travail actuel
n’ait que peu de rapport avec cette industrie. Lorsque l’on travaille,
mois après mois, sur des comics de super-héros, on développe
des habitudes dont il est nécessaire de se défaire pour
pouvoir trouver de nouvelles directions.
 Ces
travaux vous ont-ils permis de vous faire un nom ? Ces
travaux vous ont-ils permis de vous faire un nom ?
"Se faire un nom" est une drôle d’expression lorsque l’on
parle de comics américains. Mais dans le petit monde des gens
qui lisent des comics, mon nom est assez populaire depuis 1991 (trois
ans après la parution de Batman : Year One) pour
pouvoir attirer les gens vers ma revue Rubber Blanket, même
si cela n’a rien à voir avec ce que je faisais avant. De plus,
devenir populaire dans l’industrie du comics ne veut pas obligatoirement
dire que l’on soit reconnu en dehors de ce système, à
moins que quelqu’un veuille faire un film de vos travaux. En dehors
de ce monde, personne n’a que faire de savoir qui écrit ou
dessine les histoires de super-héros. Mais certains travaux,
plus parallèles ou plus individuels peuvent avoir du succès
parmi des gens qui ne lisent pas de comics ; des directeurs artistiques
qui n’ont rien à foutre de lire un épisode des X-men,
peuvent offrir à des artistes comme Jaime Hemandez, Charles
Burns, Dan Clowes ou moi, des boulots d’illustrations ou de comics
très intéressants. Évidemment, les gens voient
plus ces travaux de commande que notre vrai travail.
Comment
en êtes-vous venu à travailler sur l’adaptation en comics
du livre de Paul Auster, Cité de verre ?
Art Spiegelman m’a demandé si j’aimerais être associé
au projet Neon Lit, et a suggéré le livre d’Auster.
Plus tard, Paul Karasik est venu collaborer à ce projet. Nous
nous sommes rencontrés avec Paul Auster au début, puis
au milieu de notre travail, mais la plupart du temps, Paul Karasik
et moi sommes restés seuls pour réaliser l’adaptation.
L’aspect graphique de cette adaptation est
très sobre, tellement d’ailleurs que les dessins semblent souvent
céder la place à la narration. Pensez-vous que les dessins
doivent être lus, plutôt que regardés ?
Le langage et le ton du livre lui-même sont très
sobres, donc je pense que le langage graphique de l’adaptation est
approprié. Je ne suis pas d’accord avec vous pour dire que
le dessin cède la place à la narration. Depuis le départ,
nous étions très conscients que les mots et les images
devaient être inséparables. S’il semble que la narration
prenne le pas sur l’image, c’est parce que nous devions traduire un
langage verbal conçu sans aucune composante visuelle. Le challenge
pour nous était de trouver des métaphores visuelles
qui pourraient remplacer ou augmenter le texte original. Une bande
dessinée existe sur une page en séquences, elle est
plus proche de la littérature que, par exemple, un film. Les
mots deviennent visuels, les images doivent être lues. Dans
les très bons comics, il n’y a rien de décoratif ou
de gratuit. Chaque mot, chaque marque, chaque design sert la fonction
narrative, quelque que soit la forme que doit prendre cette narration.
C’est l’interaction entre les mots et les images qui donne à
la bande dessinée ses propriétés uniques.
Qu’a
pensé Paul Auster de votre adaptation ?
Autant que je sais, Auster en est content. Mais les comics ne
l’intéressent pas vraiment. Il était d’accord avec le
projet parce qu’il fait confiance à Art Spiegelman, et Art
nous fait confiance, à Paul Karasik et moi-même.
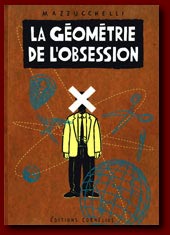
La
géométrie de l’obsession,
beau volume à la couverture sérigraphiée,
propose en ses pages trois récits de longueurs variables
: Manqué de peu, sobre par son graphisme et sa
bichromie, est un récit stupéfiant et onirique
dans lequel il est question de comète et de dinosaures.
Discovering America utilise lui aussi deux couleurs -rouge
brique et bleu verdâtre- mais donne l’impression d’une
trichromie, le noir étant obtenu par juxtaposition des
deux tons. Ici, on parle d’un cartographe essayant de refaire
le monde à partir de chez lui. Stop the air nude
commence comme un manga parodique, mais peu à peu le
rire se force, jaunit, la conclusion se fait grotesque et terrifiante.
Trois récits, trois personnages avides d’abstractions,
retranchés dans leur théorème personnel
et ne s’assumant pas. Un graphisme d’une simplicité et
d’une maîtrise confondante, une narration cinématographique
et impeccable pour une trinité réussie. Mazzucchelli
a l’art de transcender des visions maladives et des réalités
suffoquantes, et d’en produire du sens.
Ambre
|
Aux
États-Unis, vous avez publié votre propre comics, Rubber
Blanket Quels sont les avantages à s’auto-publier et quels
en sont les inconvénients ?
Rubber Blanket n’a pas été publié
depuis des années. Parmi les raisons de sa publication, j’avais
commencé à faire de nouvelles histoires, en 1989/90,
et il était clair pour moi qu’il n’existait pas vraiment de
recueil approprié à ce genre d’histoire, à part
peut-être Raw magazine. Je voulais que ces histoires
existent dans un contexte très particulier, quelque chose qui
garde l’atmosphère et la justesse des tons, quelque chose qui
annonce à travers sa forme et son design l’intention d’une
expérience littéraire et graphique à part. Je
voulais aussi contrôler l’impression et le tirage, du fait de
la technique spéciale des deux couleurs que j’avais utilisées.
Le côté positif est que j’ai dû beaucoup apprendre
au niveau du design, de l’impression, et du travail de distributeur
et d’éditeur. Toutes ces choses sont importantes à savoir.
Le côté négatif, c’est que cela coûte très
cher et que la plupart de votre temps n’est pas consacré à
la création. Mais que je continue ou non à publier mon
propre travail, j’ai, à présent, une meilleure compréhension
des différents stades de la production d’un livre.
Comment
définiriez-vous les histoires de Rubber Blanket ?
Je ne suis pas sûr de vouloir les définir. Pourquoi
pas des fictions.
Les
éditions Cornélius ont sorti La géométrie
de l’obsession comportant trois histoires de votre revue. Quels
sont vos sentiments, en tant qu’auteur et éditeur sur cette
traduction ?
Je suis très excité de voir mon travail publié
en France et très content de la présentation du livre,
et des livres des éditions Cornélius en général.
Je crée mes propres histoires depuis pas mal d’années
déjà, mais beaucoup de lecteurs français n’ont
rien lu d’autre de moi depuis ces horribles versions françaises
de Daredevil et de Batman, il y a de cela presque dix
ans. J’espère que mon travail sera bien reçu. Cornélius
comprend bien mon travail et je pense que la façon dont il
l’a présenté est la meilleure. Il a publié un
second livre intitulé La soif. Ce livre présentera
trois histoires déjà publiées ici, aux États-Unis.
Pour ma part, je donne des cours de bande dessinée dans une
école d’art. Je continue de faire périodiquement des
illustrations pour The New Yorker et j’ai commencé à
travailler sur quelque chose qui, je l’espère, deviendra bientôt
un roman graphique.
Certains
auteurs français ont créé à Paris l’Oubapo,
une sorte de laboratoire de la bande dessinée, avec pour objet
la recherche de nouvelles formes narratives. Que pensez-vous de cette
démarche ?
Je ne suis pas sûr d’être très familier avec
ce dont vous me parlez. Pour ma part, j’ai toujours pensé que
Rubber Blanket était, en partie, une sorte d’atelier
pour l’exploration du langage et de la structure du comics. D’autres
artistes, associés à la revue, étaient des peintres
et des sculpteurs -et non des dessinateurs- qui s’intéressaient
au comics. Je pense qu’il est intéressant de voir quelles directions
prendront leurs idées. Je soutiens ceux qui cherchent de nouvelles
façons de faire bouger les comics, ce médium a un potentiel
incroyable.
|

 Il
nous semble que vous êtes plus connu en France comme auteur
dans la production indépendante que comme illustrateur de séries
telles que Daredevil ou Batman. Est-ce la même
chose aux Etats Unis ?
Il
nous semble que vous êtes plus connu en France comme auteur
dans la production indépendante que comme illustrateur de séries
telles que Daredevil ou Batman. Est-ce la même
chose aux Etats Unis ? Ces
travaux vous ont-ils permis de vous faire un nom ?
Ces
travaux vous ont-ils permis de vous faire un nom ?