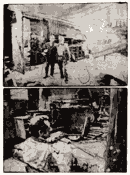MOLOCH | Michaël Matthys
Du
Minotaure au Moloch
ou
la
prise de conscience de Michaël Matthys
par
Monsieur
Vandermeulen
&
M. Xavier
P. Löwenthal,
linguiste
et esthéticien à
l’Institut National de la Radioélectricité.

S’il faut en croire les voix qui parcourent les gravures de Moloch, Michaël Matthys ne savait véritablement pas à quoi s’attendre quand il entreprit son reportage photographique sur le site de Cockerill Sambre. Seul le goût de la découverte semblait guider ce jeune bédéiste vers les coqueries wallonnes, sinon la volonté de réunir le plus grand nombre de clichés possible ; et ce matériau vitement acquis de lui inspirer la réalisation d’une bande dessinée. Nous le savons, de nos jours, la jeunesse n’attend plus que trop d’idées lui viennent avant d’oser l’amorce d’une création, et jette son dévolu sur une quelconque entreprise, avec une fougue proportionnelle à la trivialité du sujet.
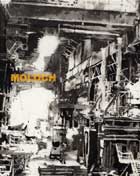 Pour
avoir rencontré le graveur carolorégien, il nous a semblé
d’abord que cette lecture était pertinente. Les entrevues lointaines
que nous avons eues avec le jeune Michaël Matthys – vous
savez comme il nous plaît de rencontrer la jeunesse créatrice
– auront tôt fait de nous instruire des qualités humaines
de ce jeune Wallon, saisissantes de modestie et de naturel, et qui auront
su s’offrir à nous avec une candeur déconcertante (modestie
et naturel qui sont, par ailleurs, on ne le répétera jamais
trop, la propriété consubstantielle et quintessencielle
des populations de la Sambre). Ainsi, nous avons toute raison de croire
le protagoniste du récit, quand il nous dit qu’il est l’auteur ;
Michaël Matthys, nous en répondons, ne saurait mentir. Moloch,
récit réaliste s’il en est, nous place dès lors
en face d’une vérité nue, une authentique bande dessinée-reportage.
Nous dirions même, paraphrasant le jargon télévisuel,
que Moloch propose les gravures d’un document – la formule nous
amuse – réalisé presse à l’épaule
(1).
Pour
avoir rencontré le graveur carolorégien, il nous a semblé
d’abord que cette lecture était pertinente. Les entrevues lointaines
que nous avons eues avec le jeune Michaël Matthys – vous
savez comme il nous plaît de rencontrer la jeunesse créatrice
– auront tôt fait de nous instruire des qualités humaines
de ce jeune Wallon, saisissantes de modestie et de naturel, et qui auront
su s’offrir à nous avec une candeur déconcertante (modestie
et naturel qui sont, par ailleurs, on ne le répétera jamais
trop, la propriété consubstantielle et quintessencielle
des populations de la Sambre). Ainsi, nous avons toute raison de croire
le protagoniste du récit, quand il nous dit qu’il est l’auteur ;
Michaël Matthys, nous en répondons, ne saurait mentir. Moloch,
récit réaliste s’il en est, nous place dès lors
en face d’une vérité nue, une authentique bande dessinée-reportage.
Nous dirions même, paraphrasant le jargon télévisuel,
que Moloch propose les gravures d’un document – la formule nous
amuse – réalisé presse à l’épaule
(1).
Averti qu’il est devant un récit réaliste, au lecteur de comprendre l’invite qui lui est faite de suivre la progression du narrateur jusqu’au cœur de l’immense usine. Mais déjà, chose amusante, la narration vient à nous contredire : elle nous fait part, par le truchement de ses dialogues toujours, de l’intention qu’a notre graveur de baptiser son œuvre future Le Minotaure. Le récit se déployant, Michaël Matthys nous annonce par là que ses motivations étaient plus ordonnancées que nous semblions le penser tout d’abord, dans l’introduction de ce texte ; et cette référence au Minotaure de s’adjoindre comme élément contradictoire au postulat qui voulait que Michaël Matthys, comme bien des jeunes gens de son état, n’ait eu qu’une seule idée pour ce livre ! Plus, l’auteur signale à ses lecteurs sa connaissance d’un texte classique issu de la mythologie ! Saluons cette instruction, trop rare chez les jeunes écrivains d’illustrés.
Permettez-nous d’entamer encore une légère digression, pour rappeler à notre jeune lectorat illettré (on ne nous accusera pas d’élitisme !) qui est l’hideuse Bête Minotaure. Anatomie humaine dominée d’une face de taureau, le Minotaure naquit de l’irrépressible amour zoophile de la reine de Crète, Pasiphaé, pour un taureau blanc que le roi Minos, son époux, avait refusé de sacrifier à Poséidon (comme la piscine). Épouvanté par la naissance du monstrueux bâtard, le roi voulut en cacher la nouvelle à ses sujets et fit construire par Dédale un palais parsemé de nombreux couloirs entrelacés qui donnaient sur des salles aux architectures sophistiquées, débouchant elles-mêmes sur des passages enchevêtrés – oui, jeunes gens, un labyrinthe ! Minos ordonna que l’on y plaçât le fruit de la relation adultérine de la reine. Et pour que celui-ci survive, on le nourrissait chaque année de la chair fraîche de quatorze Athéniens.
On
concédera à l’auteur que son analogie est très
appropriée. Malheur à qui s’égare dans l’antre
fantastique de John Cockerill. L’angoisse lui serre bientôt
la poitrine, comme elle étreint la proie du Minotaure. Abandonne
tout espoir ! semble être l’injonction de cet inferno.
Monsieur Matthys n’est pas Thésée. Nul fil d’Ariane, pas
même narratif, ne viendra le sauver.
Si bien que
nous réalisons, petit à petit, que l’auteur savait, sans
véritablement connaître l’endroit visité, quelles
inspirations allait lui procurer cette traversée du dédale
d’acier. Car oui, finalement, le sujet de Michaël Matthys n’est
que cela : un voyage dans Cokerill Sambre. On se souvient que l’auteur
avait tenté, jadis, un Aguirre, autre voyage sans retour. Matthys
est-il Orphée, trouve-t-on une Eurydice dans un fracas de tôles
noircies ?
Toutefois,
si ténue soit l’intrigue, elle ne fait nullement de Moloch
un livre dérisoire. À bien y réfléchir –
bien sûr, cette étape pourrait paraître incongrue
à notre lecteur –, cette évocation du Minotaure n’est
pas innocente. Nous avancerons même que cet indice est la pièce
centrale et capitale de l’ouvrage, la clé qui pend aux trois
cous de Cerbère. Car bien sûr, Le Minotaure n’est
pas demeuré le titre de l’ouvrage, Moloch s’y est substitué.
Mais pourquoi donc Michaël Matthys nous fait-il l’aveu de cette
substitution, et qu’y voir ?
Les
primes traces du Moloch, dont le sens étymologique ramène
aux langues sémitiques et signifie roi, se situent dans
le Lévitique de l’Ancien Testament. Moloch était une divinité,
glorifiée par les Moabites et les Cananéens, et plus encore
par les peuples de Tyr et de Carthage (en témoignent quelques
pages du Salammbô de Flaubert, mais ne sollicitons pas
trop l’esprit de notre lecteur, nous pourrions l’effrayer). Culte cruel,
Moloch rappelle la capacocha des Incas ou la légende de Cronos,
qui avalait ses propres enfants et, bien sûr aussi, celui du Minotaure.
À cette différence que Moloch n’était pas un monstre
crée par les divinités mais un Dieu véritable.
Jahvé d’ailleurs, y voyant une rivalité trop sérieuse,
défendit aux hommes de sacrifier ses enfants à Moloch,
sous peine de mortelles représailles. Moloch, plus encore que
le Minotaure, incarne le culte de la Peur et du Mal.
Ce glissement
de sens survient au beau milieu du voyage, quand l’action se situe au
centre même du monstre industriel. C’est précisément
ici, à l’instant même où le narrateur répond
à la question de l’ouvrier qui l’interroge (tel le sphinx), que
sa traversée s’intitulera Le Minotaure, c’est à
ce moment précis que la conscience de l’auteur, parvenu
à ce point de son œuvre, s’illumine. Nous sommes au faîte
du récit, à la porte, au passage, à la béance
par laquelle, ailleurs, surgit le mythe, ici, le glissement de sens :
le Minotaure passe le relais à Moloch.
Le monstre
Moloch, dieu de feu dévorant les enfants du peuple, a pris la
place du monstre-créature, mi-homme mi-taureau, abandonné
dans le dédale d’acier. Le dédale, l’usine, cette seconde
Nature édifiée par la folie des hommes. Que nous enseigne
cette commutation sémantique ? Peut-être la compassion
avait-elle encore trop de place dans l’idée que Michaël
Matthys se faisait de la bête claustrée, malheureuse victime,
en fin de compte, de la folie des hommes et des dieux ? Il se pourrait
que la réalité édifiante du site industriel lui
ait interdit tout apitoiement, et la conscience de Michaël Matthys
dut alors y voir plutôt l’ignoble monstre dévoreur de vie,
osant jusqu’à braver la Loi de Yahvé. Sans doute dut-il
sentir, dans l’antre métallique dévoreur d’acier, la palpitation
d’une vie non pas contenue, comme le Minotaure à l’intérieur
du labyrinthe, mais l’englobant tout entier, le dévorant ?
Les hommes qui ont bâti ce Monstre, seconde Nature, ne se sont-ils
pas rendus coupables de démiurgie, n’ont-ils pas, prométhées
modernes, ourdi comme le Golem qui les dévora ? Doit-on
les plaindre alors, ou les blâmer ?
Il
ne semble pas en tout cas, malgré son thème identique,
que ce soit la lecture du Moloch d’Alexandre Ivanovitch Kouprine
qui ait orienté ce choix ; les dessinateurs de bandes dessinées
ne lisent pas les chef-d’œuvres du roman réaliste russe.
Mais rassurons
le lecteur, Moloch n’est pas un livre politique, il est bien
mieux que cela : il est le long cheminement d’une conscience, un
hommage, et quel plus beau tribut que ce magnifique poème pouvait-on
offrir aux métallurgistes de Cockerill Sambre ! Ce que dit
Michaël Matthys aux ouvriers de son Moloch, à ces
pupilles de la terre carolorégienne jetés en pâture
à la Bête, est aussi émouvant qu’une tirade du Général.
Car le message du jeune Michaël n’est-il pas, in fine, aussi
éclatant et magistral qu’un "Je vous ai compris !" ?
On
pourra regretter encore la fâcheuse interprétation qu’une
lecture trop rapide pourrait entraîner : la seconde Nature,
d’origine démiurgique, l’usine, serait l’œuvre tragique des grands
industriels qui, pour expier ce crime, durent assouvir l’énorme
appétit de la Machine en lui offrant l’holocauste des vies
d’innocents ouvriers, employés à produire l’acier
destiné à consolider le monstre. On rencontre hélas !
encore de ces esprits égarés ou fanatisés pour
qui, ingrats, nos fiers chevaliers d’Industrie visionnaires seraient
des méchants. Mais sachons dire à ceux qui vouèrent
leur vie et leur argent à nous bâtir une vie de luxe et
de volupté : merci !
Nous déplorerons
encore que l’illettrisme soit la tare endémique des classes ouvrières
et que semblable témoignage, si beau soit-il, touchera probablement
bien peu les manouvriers, trop absorbés qu’ils sont à
se griser ou à assener quelques justes corrections à leur
conjointe infidèle.
MV. & XL.
MOLOCH
| Michaël Matthys
96 pages | 22 EU | éditions FRMK
ISBN 2-930204-42-7
[site]
MOLOCH
| Alexandre Kouprine
161 pages | Les Editions du Monde Nouveau – 1922
7,50 francs | ISBN néant
Errata
La récente relecture de Formes et Politique dans la bande dessinée (Peeters-Vrin – 1998), de notre collègue Jan Baetens, nous conduit à revoir l’appréciation que nous portions jusqu’alors sur la jeune création belge. L’une d’elle s’avançait sous le nom de "Fréon" et elle est aujourd’hui inclue au "Frémok", dans un nouvel esprit d’entreprise en quête de synergies. Une autre, moins connue mais non plus modeste, se fait appeler ridiculement "La 5e Couche", hommage baroque à une obscure théorie esthétique en vogue dans les effarantes "sixties".
Il
semble en effet que nous ayons méjugé la place qu’occupe
ce cartel sur l’échiquier politique, persuadés que nous
étions de voir, dans l’entreprise artistique de ces jeunes graphistes
belges, l’expression des meilleures valeurs patrimoniales.
À lire
D’art et de Politique, l’ultime chapitre de son ouvrage, M. Baetens,
consultant théoricien de nos jeunes gens (pour que bonne communication
se fasse, la jeunesse sait souvent mieux que quiconque les fonctions qu’il
lui faut déléguer), la bande dessinée issue des ateliers
du Frémok Nord [site]
répondrait en réalité à la définition
d’un art engagé, sinon subversif ! Étonnant !
La 5e Couche, quant à elle, répand une prose
calamiteuse, pétrie d’arrogance et de prétention, sur son
site-manifeste [site], dont le
contenu politique, latent le plus souvent, devient parfois explicite et
grossier. Monsieur Baetens aurait-il eu raison ?
Ainsi, dès
1998 – Dieu ! qu’il y a longtemps ! l’avions-nous mal lu ?
–, M. Baetens nous invitait à considérer les volumes Frigobox
(revue collective de bande dessinée des éditions Fréon)
comme d’authentiques lieux de résistance, matérialisation
livresque d’une politique activiste prêchant, pêle-mêle,
"refus", "destruction", "dénonciation" et "transgression" (sic !).
Les "valeurs" défendues par La 5e Couche sont, en vrac
(pas de chichi chez les insurgés) : l’insoumission, la haine
des conventions et des hiérarchies, le mépris des limites…
En un mot comme en cent, la haine de l’ordre. Manifestement, Frémok
et La 5e Couche se cherchent un père.
Notre
lecteur nous permettra de ne pas manier le même lyrisme que notre
collègue, dont nous craignons qu’il ne soit atteint de la folie
du tout-politique, maladie née de cette gauche jamais remise de
sa chance inexploitée de 1968, malgré son sournois dynamitage
des mœurs. Ne nous appesantissons pas sur les efforts de M. Baetens, lorsqu’il
tente, de manière touchante, de traduire les nombreuses fautes
d’orthographes qui parsèment les Frigobox en "fautes de
frappes volontaires", ou autre déclaration d’allégeance
à Raymond Roussel ; nous serions ici trop féroce.
Nous apprenons,
ailleurs, que les "fautes" seraient intentionnelles, affaires
de style. On nous explique, à propos d’une colossale erreur d’impression
d’un Frigobox – une planche imprimée en reflet, illisible
(cf. frigobox n°4 p.88) – qu’il s’agit d’une subversion,
qu’avec ces auteurs, une erreur même grossière passe pour
du style et qu’on en cherche le sens et que, même, on le trouve.
N’est-ce pas plus intéressant que toutes les évidences du
beau langage ? Tout a ainsi du sens, pourvu que le lecteur en crée.
C’est bien commode. La beauté se trouve ainsi partout. Dès
lors, certains plasticiens ont-ils prétendu nous montrer les beautés
(sic !) des bretelles autoroutières ou des chancres industriels.
Le manifeste déjà cité abonde en ce sens, prônant
la même désolante confusion de tous les genres. Ainsi peut-on
lire : (Affranchie) de toute espèce de subordination dévote
à un Modèle, (notre oeuvre) entend échapper
aux cloisonnements ineptes qui veulent que la bande dessinée soit
populaire et la littérature intellectuelle. Et tout de se valoir.
Nous répondons : non. Il faut séparer le bon
grain de l’ivraie et la laideur hélas ! existe, ainsi que
la vulgarité. C’est en les désignant qu’on pourra les combattre,
ce qu’a compris monsieur Matthys.
Gageons que
M. Baetens se trompe, quand il nous parle de "manifestation tonitruante
de la politique de l’écart", et que l’engagement qu’il perçoit
dans les ouvrages de ses jeunes poulains politiques ne tienne en réalité
que du babil impuissant, comme il arrive à tant de pratiques sauvagement
modernes, dont le vrai modèle est moins la révolution que
la potacherie involontaire.
Sachons tirer les leçons de nos déconvenues. Nous voilà bien instruits qu’il est bien plus convenable et même avantageux d’être révolutionnaire en atelier chauffé, plutôt que sur une barricade. Si nous étions taquins, nous intitulerions les rêveries frémokiennes et quintacapistes "la Révolution dans le Boudoir", rendant ainsi hommage à tel autre grand homme. Mais, que le lecteur soit rassuré : si l’art pouvait changer le monde, cela se saurait ! Laissons d’ailleurs le dernier mot aux tâcherons de La 5e Couche : "fondamentalement, le public n’a rien à faire dans la relation qui lie l’auteur et son travail". Nous ne craignons donc rien.
MM.
X.P.Löwenthal & Vandermeulen,
pour
eux-mêmes et leur Cause.
Mais
qui est Monsieur Vandermeulen
FORMES
ET POLITIQUE DE LA BANDE DESSINÉE | Jan Baetens
154 pages | éditions Peeters-Vrin
ISBN 2-87723-414-2